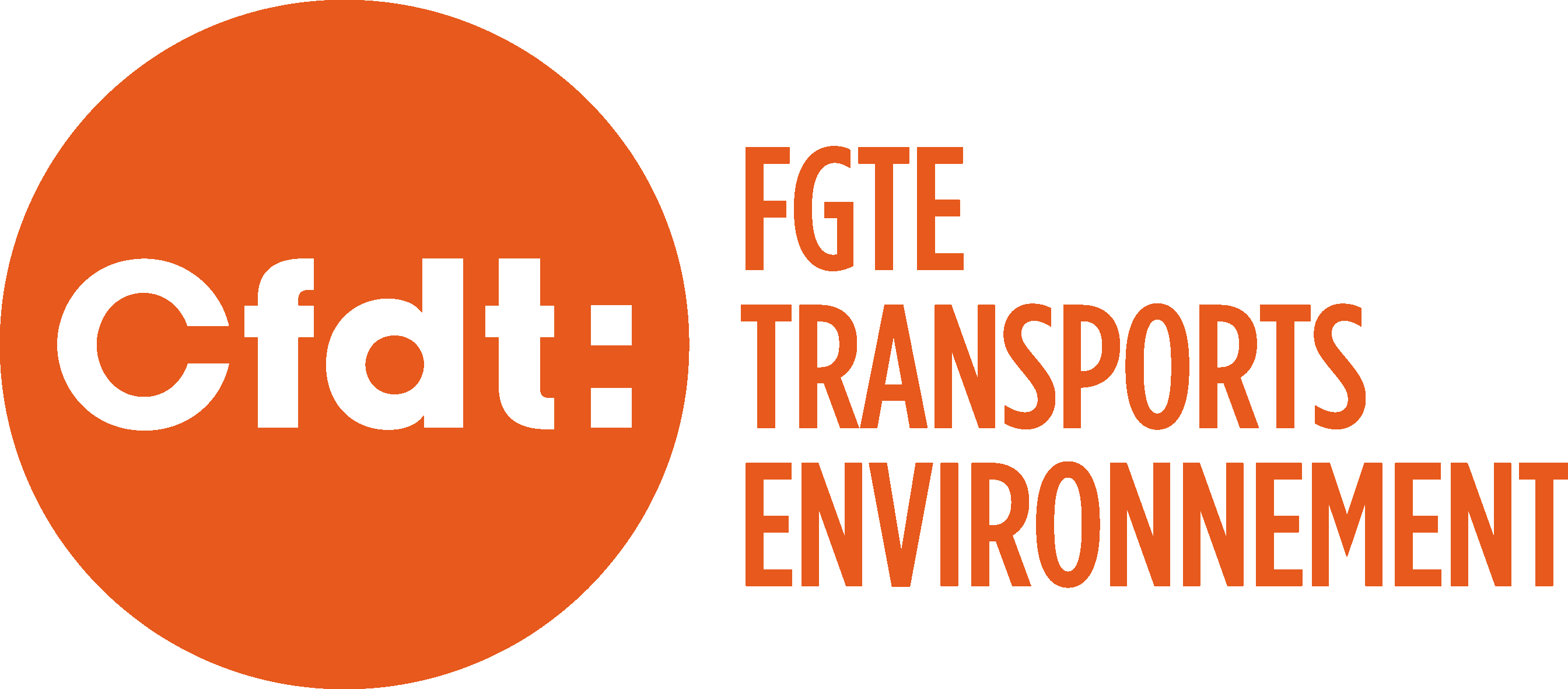Suppression de la limitation des mandats successifs au CSE
La limitation à trois mandats successifs au sein du Comité Social et Économique (CSE) appartient désormais au passé. La loi de transposition des accords nationaux interprofessionnels, adoptée le 14 novembre 2024 et publiée au Journal Officiel, marque un tournant majeur dans l’organisation de la représentation du personnel en entreprise.
L’article 8 de la loi n°2025-983 du 22 octobre 2025 supprime en effet la règle qui imposait un plafond de trois mandats consécutifs pour les membres du CSE, une contrainte qui s’appliquait de façon obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés, et pouvait être négociée dans celles de 50 à 300 salariés. Dorénavant, bien que la durée d’un mandat reste fixée à quatre ans, les membres du CSE pourront être réélus sans limitation du nombre de mandats.
C’est une victoire de la CFDT qui a combattu cette ignominie du gouvernement de l’époque qui pensait à tort que le dialogue social était dans l’ADN des entreprises
Cette limitation des 3 mandats était devenu un frein aux convictions syndicales da la représentation du personnel. La raison l’a enfin emportée
Renforcement du cadre pour l’emploi des salariés seniors
Avec la transposition de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 14 novembre 2024, le cadre législatif relatif à l’emploi des salariés expérimentés est consolidé. Une nouvelle obligation de négociation sur l’emploi des salariés expérimentés, en prenant en considération leur âge, est instaurée, aussi bien au niveau de l’entreprise (+de 300 salariés) qu’à l’échelle de la branche professionnelle.
Les branches professionnelles devront, après un diagnostic préalable, engager une négociation tous les trois ans concernant l’emploi et les conditions de travail des salariés expérimentés. Cette négociation portera sur plusieurs thèmes essentiels :
- Le recrutement des salariés expérimentés
- Leur maintien dans l’emploi
- L’aménagement des fins de carrière, notamment à travers l’accompagnement vers la retraite progressive ou le temps partiel
- La transmission des savoirs et compétences, via des missions de mentorat, de tutorat ou de mécénat de compétences
D’autres sujets pourront également être abordés lors de ces négociations, comme les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement des salariés expérimentés, la santé au travail, la prévention des risques professionnels, ainsi que l’organisation et les conditions de travail. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord de branche pourra prévoir un plan d’action dédié.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, la question de l’emploi des salariés expérimentés devient une négociation obligatoire et autonome, indépendante de l’accord de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Cette négociation devra avoir lieu au moins une fois tous les quatre ans, ou tous les trois ans en l’absence d’accord d’entreprise aménageant les négociations obligatoires. Les thèmes abordés seront identiques à ceux de la branche.
Le contrat de valorisation de l’expérience (CVE)
La loi introduit, à titre expérimental, le « contrat de valorisation de l’expérience » (CVE), visant à faciliter l’embauche des demandeurs d’emploi âgés d’au moins 60 ans. Dès la signature du CVE, le salarié doit fournir à l’employeur un document précisant la date prévue de son départ à la retraite à taux plein.
Une fois les conditions requises pour la liquidation de la retraite à taux plein remplies, l’employeur pourra procéder à la mise à la retraite d’office du salarié, qui dans ce cas-là bénéficiera alors d’une indemnité de départ équivalente à celle d’un licenciement prévu à l’article L1237-7 du code du travail.
Les articles L. 1237-6 et L. 1237-7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV de la loi 2025-989 du 24 octobre 2025, ni celles prévues à l’article L. 1237-5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.
Aménagement des fins de carrière
Des mesures spécifiques sont prévues pour favoriser l’aménagement des fins de carrière. La loi encadre notamment le refus de l’employeur d’un passage en retraite progressive. Elle permet également, dans le cadre d’un temps partiel de fin de carrière, d’affecter l’indemnité de départ à la retraite afin de compenser, en tout ou partie, la perte de revenu consécutive à la réduction du temps de travail, y compris pour les forfaits-jours.
Dispositions relatives à la reconversion professionnelle
La loi intègre certaines mesures issues de l’ANI du 25 juin 2025 sur les reconversions professionnelles. À compter du 1er janvier 2026, un nouveau dispositif, la « période de reconversion », est instauré. Ce dispositif permet à tout salarié de suivre une formation certifiante en vue d’une mobilité professionnelle, interne ou externe à l’entreprise. La durée de cette période sera comprise entre 150 et 450 heures sur 12 mois, avec une possible extension jusqu’à 2 100 heures sur 36 mois par accord d’entreprise ou de branche.
Dans le cas d’une reconversion interne, le contrat de travail et la rémunération du salarié sont maintenus. Si la reconversion est externe, le contrat de travail est suspendu, permettant la conclusion d’un CDI ou d’un CDD d’au moins six mois chez un autre employeur. Si la période d’essai est concluante, le contrat initial est rompu ; dans le cas contraire, le salarié réintègre son entreprise d’origine. Le financement de ce dispositif est assuré par les OPCO, dans la limite d’une dotation fixée.
Évolutions de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel, désormais nommé « entretien de parcours professionnel », doit avoir lieu au cours de la première année suivant l’embauche, puis tous les quatre ans (au lieu de tous les deux ans précédemment). L’entretien de bilan est désormais programmé tous les huit ans, contre six auparavant.
Par ailleurs, un entretien de parcours professionnel doit être organisé dans les deux mois qui suivent la visite médicale de mi-carrière, c’est-à-dire durant l’année des 45 ans, afin d’examiner les éventuelles mesures d’aménagement proposées par le médecin du travail. Enfin, lors de l’entretien professionnel intervenant dans les deux années précédant le 60e anniversaire du salarié, les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagement de fin de carrière devront être abordées en plus des thèmes habituels.